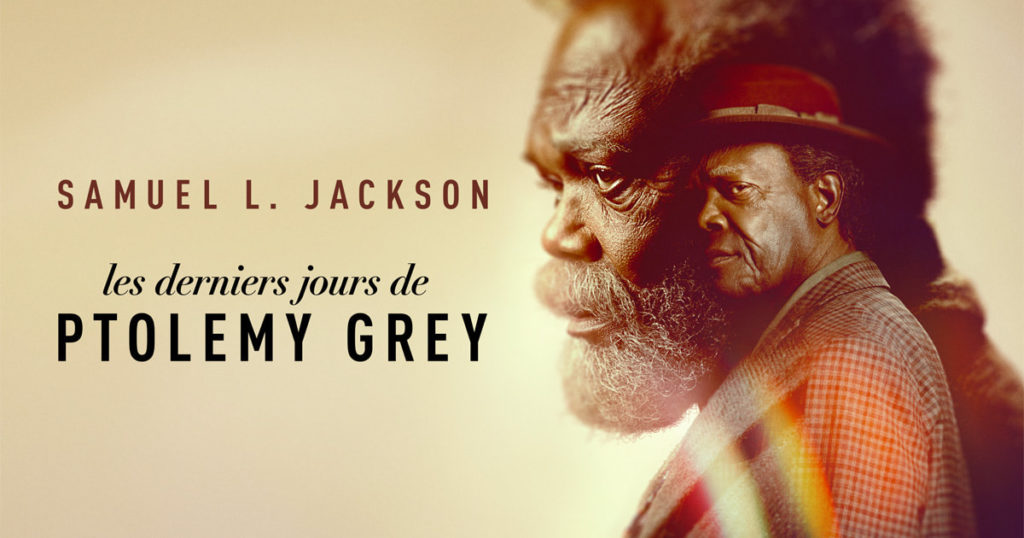Au moment où l’on se prépare à retourner sur la Lune avec la mission Artemis I et le SLS, certaines voix s’élèvent pour affirmer une fois encore que nous n’y sommes jamais allé en 1969. Même Thomas Pesquet s’en ai ému sur les réseaux sociaux. Un garçon si calme et modéré d’ordinaire.
Mais pourquoi nier aujourd’hui l’existence de ces missions spatiales ? Quel est l’intérêt des personnes qui répandent ces rumeurs ?
Bon il y a les crétins conspirationnistes, ceux qui étaient persuadés que la COVID-19 n’était qu’une vaste manipulation du pouvoir mondial jusqu’au jour où il sont tombés malades. Des crétins donc.
Il y a les fanatiques religieux qui croient encore que la Terre est plate. Ceux-là n’ont qu’à faire le tour du monde à pied en ligne droite pour comprendre, surtout s’ils ne savent pas nager.
Il y a également des personnes, souvent celles qui alimentent ces polémiques ridicules, suffisamment intelligentes pour distiller des contres vérités dans l’information et semer les germes du doute, et qui dépensent beaucoup d’argent et d’énergie à noyer les imbéciles dans leurs mensonges.
Ceux qui tombent dans le piège possèdent souvent le même profil contestataire, critiquant en vrac le pouvoir, la science, prônant des médecines parallèles hasardeuses, voyant des soucoupes volantes dans le ciel, mais ne vivant pas forcément dans des yourtes pour autant en élevant des chèvres. Des personnes électro sensibles surfant sur Internet avec leur téléphone portable.
« Parce que les gouvernements mentent trop, tout le temps. Les gens sont bien obligés de trouver des réponses par eux même et parfois ils se gourrent, ou pas. Les pôles n’ont pas fondu, le covid n’est pas la peste, ya toujours de l’ozone, et on a les pieds au sec. Faut plus mentir »
Quel intérêt ont ces gens à décrédibiliser la science ? Provoquer une révolution planétaire contre le capitalisme et les tyrans ?
Je ne cautionne pas forcément la course à l’espace même si elle nourrit mes rêves, et je désapprouve le tourisme spatial faute de pouvoir m’offrir un billet.
Je constate jusque que sans le spatial nous n’aurions pas de satellites et sans satellite nous serions aveugles, sourds et muets. Sans l’exploration spatiale, nous penserions encore être le centre du monde et nous redouterions peut-être l’attaque des petits hommes verts.
Je ne suis pas de ceux qui érigent la science en religion, d’ailleurs je me méfie de toutes les dogmes et religions. Je pense par contre que la compréhension de ce qui nous entoure éloigne de nous l’obscurantisme.
Est-il nécessaire d’aller sur la Lune ou sur Mars ? Je n’en sais rien. Christophe Colomb avait-il raison de partir vers le couchant ? Je n’ai pas la réponse non plus. Ce qui est certain, c’est qu’il est bien arrivé aux Bahamas, et ça personne ne le conteste aujourd’hui. Alors pourquoi s’acharne-ton à nier le succès des missions Apollo ?
C’est vrai que le lancement de la mission Artemis I a nettement baissé mon habituelle productivité. Lundi après-midi, je suis resté scotché à la chaîne de la NASA de 13h à 16h au lieu de travailler et samedi, tout en concevant un SLS en Lego sur le mac avec le logiciel Studio, je suivais un nouveau report du lancement en direct.
Si la NASA n’est pas foutue de lancer un SLS avec une capsule Orion vide en 2022, comment aurait-elle pu envoyer deux astronautes sur le sol lunaire en 1969. Sérieusement ?
Je vous laisse, j’ai des Lego à commander. Rendez-vous le fin septembre pour une nouvelle tentative.