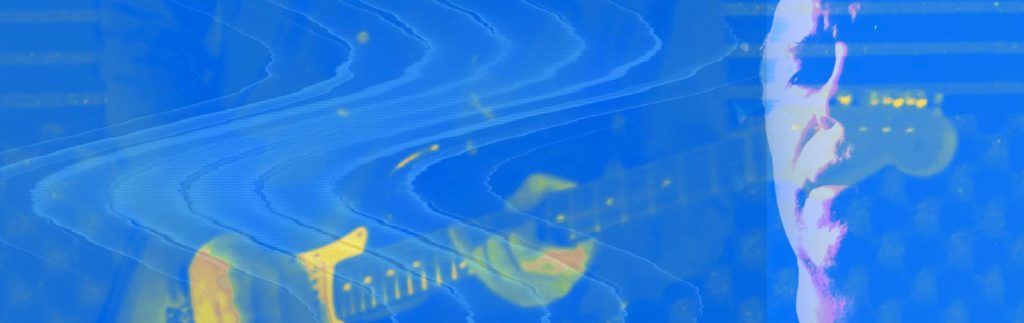J’avais reçu 230503 en même temps que plein d’autres promotions du label Bird Robe Records et découvert par la même occasion le groupe anubis. Je les suis fidèlement depuis et j’ai même eu la chance de les écouter en live lors de leur première tournée Européenne au festival Prog The Castle.
230503 trône fièrement dans ma discothèque et me voilà aujourd’hui avec la Deluxe Anniversary Edition, deux CDs comportant la réédition de 2020, la version originale ainsi que des captations live, un total de 38 titres que je possède déjà dans d’autres éditions.
Qui a dit collectionnite aiguë ? Bref…

Cette édition est parfaite pour voyager de Strasbourg jusqu’à Lyon en voiture sur autoroute. Vous n’aurez pas à changer de disque pendant le trajet. Avec des morceaux de 12 à 22 minutes déclinés pour certains en plusieurs versions, vous en prenez pour quatre bonnes heures de musique. Et si vous en réclamez plus, le groupe a publié une vidéo d’une demie heure racontant la genèse de l’album.
Tapez 230503 dans un moteur de recherche comme Quant, vous aurez des surprises. Vous trouverez un disque de frein, un radiateur de moteur, un madrier de sapin mais nulle mention du premier album d’anubis.
230503 est un concept album, certainement le plus expérimental de leur discographie, qui parle de la perte d’un proche. Une histoire inspirée par la noyade d’un ami de David et Robert.
Les 16 versions live donnent un éclairage tout particulier sur les titres studio comme le ‘The Deepest Wound’ punk funky enregistré à Sydney en mai 2010.
Il y a également le titre ‘The Life not Taken’ en six parties, morceau fleuve de plus de vingt et une minutes issu des enregistrements de 230503 et non retenu pour la version finale. Un titre qui servira de matériel pour les morceaux ‘The Deepest Wound’, ‘Leaving Here Tonight’ et ‘Breaking Water’.
N’oublions pas le single ‘Technicolour Afterlife’ ou le ‘Anonymity’ délirant du live de mai 2010 à Amandale.
230503 Deluxe Anniversary Edition est clairement un disque pour les fans du groupe anubis et de leur premier album ou pour les personnes qui aiment écouter des morceaux déclinés de plein de manières différentes.
Ce n’est assurément pas ce qu’il faut acheter pour débuter avec anubis. Ecoutez plutôt Different Stories sorti en 2018 qui revisite leur discographie en beauté.
Teeshirt : Marillion